En 1960, le prix Goncourt est attribué à l’écrivain roumain d’expression française Vintila Horia pour son roman « Dieu est né en exil », journal apocryphe d’Ovide durant son exil à Tomes (actuelle Constanta en Roumanie) entre l’an 9 et l’an 17, année de la mort du célèbre poète. Découvert par Daniel Rops (1901-1965), le roman a séduit le jury pour son français très pur écrit par un étranger et l’histoire qu’il relate. Tout semble aller pour le mieux pour Horia qui s’apprête à recevoir son prix, sauf que le PC, sans doute informé par le dictateur communiste Ceauscescu, révèle à la presse son passé sulfureux… Et Sartre s’en mêle… Le prix ne sera jamais remis à Horia.
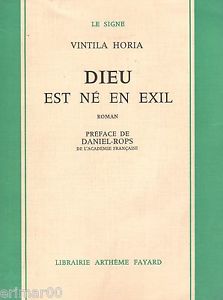
Par Hervé Bel
La lecture de ce roman m’a enchanté. Ce n’est pas, bien entendu, le chef-d’œuvre de Marguerite Yourcenar « Les mémoires d’Hadrien » dont Horia emprunte la technique narrative, faisant dire « je » à un personnage romain ayant existé et mondialement connu. Mais tout de même, on se laisse vite entraîner par cette histoire contée de façon très vraisemblable. Celui qui ne connaît Ovide que de nom se passionnera. Le connaisseur sera plus circonspect, devinant très vite les sources du texte, mais du moins en appréciera-t-il le style. C’est que, face au spécialiste, le romancier ne peut prétendre faire œuvre d’histoire. Par définition, il construit, il invente, fabule parfois, et… parle de lui. Et il est vrai que, s’agissant du texte d’Horia, pour peu qu’on s’y penche sérieusement, les « rouages de la machine romanesque » apparaissent très vite.
D’abord, Horia est un exilé lui-même. Fasciste, ayant appartenu à la garde de fer roumaine, il n’est jamais retourné dans son pays, et a erré entre l’Italie, la France et l’Espagne : il veut donc raconter l’exil. Roumain, il désire placer l’action de son roman en Roumanie. Féru d’histoire antique, il connaît Ovide exilé justement en Roumanie. Ce sera donc Ovide.
Le peu d’informations que l’on possède sur les circonstances de l’exil d’Ovide donne déjà à l’écrivain une grande liberté narrative: on ignore en effet pourquoi Ovide, adulé de Rome, fut exilé par Auguste. Les hypothèses sont nombreuses. La plus connue, reprise partiellement par Horia, est que l’Empereur, soudain vertueux, a puni Ovide pour avoir publier « L’art d’aimer », qui aurait perverti Julie, sa fille. L’ouvrage se voulait une invitation à l’amour et la séduction. Ovide y écrit : « Eloignez-vous d’ici, vous qui portez des bandelettes légères, insigne de la pudeur, et qu’une longue robe couvre jusqu’aux pieds. Je chante les amours sans scandale et les plaisirs permis » (cité par Gaston Boissier, Revue des deux Mondes, 1867). D’autres prétendent que Julie, pourtant très jeune, aurait été la maîtresse d’Ovide (la fameuse Corinne du poète), ce qui aurait déplu à Auguste. Certains, encore, estiment qu’Ovide aurait été écarté par Livie, épouse d’Auguste et marâtre de Julie, parce qu’il soutenait Agrippa, fils d’Auguste, et non son fils Tibère. On dit aussi qu’Ovide aurait appartenu à une secte pythagoricienne suspecte… Bref, on ne saura jamais vraiment, et on comprend l’excitation du romancier face à ce mystère.
Mais, pour Horia, chrétien, il y a mieux encore : on ignore presque tout de la contrée des confins de l’Empire romain où Ovide termina son existence, obligé, lui qui avait connu les raffinements extrêmes de Rome, à vivre au milieu des Gètes. Quelques textes subsistent à propos de ces barbares, et encore remontent-ils à Hérodote. Ce que dit la célèbre « Enquête » (Livre IV) ne peut qu’exciter l’imagination. Jugez-en par vous-même :
XCIV. Les Gètes se croient immortels, et pensent que celui qui meurt va trouver leur dieu Zalmoxis, que quelques-uns d’entre eux croient le même que Gébéléizis. Tous les cinq ans ils tirent au sort quelqu’un de leur nation, et l’envoient porter de leurs nouvelles à Zalmoxis, avec ordre de lui représenter leurs besoins. Voici comment se fait la députation. Trois d’entre eux sont chargés de tenir chacun une javeline la pointe en haut, tandis que d’autres prennent, par les pieds et par les mains, celui qu’on envoie à Zalmoxis. Ils le mettent en branle, et le lancent en l’air, de façon qu’il retombe sur la pointe des javelines. S’il meurt de ses blessures, ils croient que le dieu leur est propice ; s’il n’en meurt pas, ils l’accusent d’être un méchant. Quand ils ont cessé de l’accuser, ils en députent un autre, et lui donnent aussi leurs ordres, tandis qu’il est encore en vie. Ces mêmes Thraces tirent aussi des flèches contre le ciel, quand il tonne et qu’il éclaire, pour menacer le dieu qui lance la foudre, persuadés qu’il n’y a point d’autre dieu que celui qu’ils adorent.
XCV. J’ai néanmoins ouï dire aux Grecs qui habitent l’Hellespont et le Pont que ce Zalmoxis était un homme, et qu’il avait été à Samos esclave de Pythagore, fils de Mnésarque; qu’ayant été mis en liberté, il avait amassé de grandes richesses, avec lesquelles il était retourné dans son pays. Quand il eut remarqué la vie malheureuse et grossière des Thraces, comme il avait été instruit des usages des Ioniens, et qu’il avait contracté avec les Grecs, et particulièrement avec Pythagore, un des plus célèbres philosophes de la Grèce, l’habitude de penser plus profondément que ses compatriotes, il fit bâtir une salle où il régalait les premiers de la nation. An milieu du repas, il leur apprenait que ni lui, ni ses conviés, ni leurs descendants à perpétuité, ne mourraient point, mais qu’ils iraient dans un lieu où ils jouiraient éternellement de toutes sortes de biens. Pendant qu’il traitait ainsi ses compatriotes, et qu’il !es entretenait de pareils discours, il se faisait faire un logement sous terre. Ce logement achevé, il se déroba aux yeux des Thraces, descendit dans ce souterrain, et y demeura environ trois ans. Il fut regretté et pleuré comme mort. Enfin, la quatrième année, il reparut, et rendit croyables, par cet artifice, tous les discours qu’il avait tenus.
Avouons que ce texte est troublant. Les Gètes n’avaient qu’un dieu, Zalmonix, et ce dieu fait homme mourut et ressuscita, non pas au bout de trois jours, mais de trois ans…
On imagine Horia devant sa feuille blanche. Peu à peu se dessine devant lui l’intrigue de son roman : un exil après une vie éclatante, une contrée sauvage avec des barbares monothéistes, et puis les années de cet exil (de 9 à 17) au moment même où, en Judée, vit Jésus, en un temps, on le sait, où les aspirations messianiques fleurissent, où, peut-être (tout est dans ce « peut-être ») des gens ont été témoin de la Nativité.
Voilà, il tient son histoire, il peut la commencer : La tempête de neige ébranle le toit. La mer gémit au loin et ses vagues se transforment dans la nuit, en longs fantômes de glace. Ovide, tout juste arrivé à Tomes est désespéré. Son but unique : retrouver Rome, sa gloire de poète universellement reconnue. Rien ne vaut à ses yeux cette lumière dans laquelle il a toujours vécu. Tomes, au bout du monde, est la préfiguration de la Mort. Les Gètes sont des barbares dont il ne comprend pas le langage. Sa vie n’a plus de sens… Et pourtant il faut vivre, et l’on s’habitue à tout.
Le journal d’Ovide raconte comment, petit à petit, il va apprendre à renoncer, à connaître ces barbares qui le sont moins qu’on le pense. Surtout, il découvre l’absurdité du polythéisme. Il visite les endroits les plus reculés, rencontre des moines dévoués à Zalmonix, frappé par leur sagesse : Ils habitent en général les montagnes les plus hautes du pays, ne mangent jamais de viande, selon la règle de Zamonix et aussi de Pythagore. L’âge venant, Ovide apprend à se passer de tout, à réfléchir sur lui-même, pour finir, poète qu’il est, à pressentir la venue du Messie.
A la fin de sa vie, Ovide (le vrai) ne semble pas avoir été touché par la grâce, mais plutôt par le fatalisme. Il écrit:
Je suis venu dans le pays des Gètes, il faut que j’y meure, et que mon destin s’achève comme il a commencé. Que ceux-là s’attachent à l’espérance qui n’ont pas toujours été trompés par elle. Quand l’espoir n’est plus permis, le mieux est de savoir désespérer à propos et de se croire une fois pour toutes irrévocablement perdu. Il y a des blessures qui s’enveniment par la peine qu’on prend pour les guérir ; il valait mieux n’y pas toucher. On souffre moins à périr englouti tout d’un coup dans les flots qu’à les fatiguer d’un bras impuissant (cité par Boissier, op.cit.)
Le roman de Vintila Horia comporte de très beaux passages sur la nature inviolée du pays des Gètes, et même le récit d’une bataille, et des personnages remarquables qu’Ovide apprend à connaître. On ne s’ennuie pas, goûtant à un plaisir presque esthétique et qui donne l’envie furieuse d’en savoir plus sur les barbares, et ce temps fabuleux.
Ce n’est pas compliqué de trouver des sujets fabuleux dès que l’on plonge dans les temps anciens : il suffit d’un beau mystère, de coïncidences qui n’en sont pas, de personnages historiques… Mais les beaux romans sont avant tout dans la façon de faire.
Et Horia y est arrivé, quoi qu’on en dise.
Hervé Bel – décembre 2016
Last modified: 29 December 2022
[mc4wp_form id="5485"]






